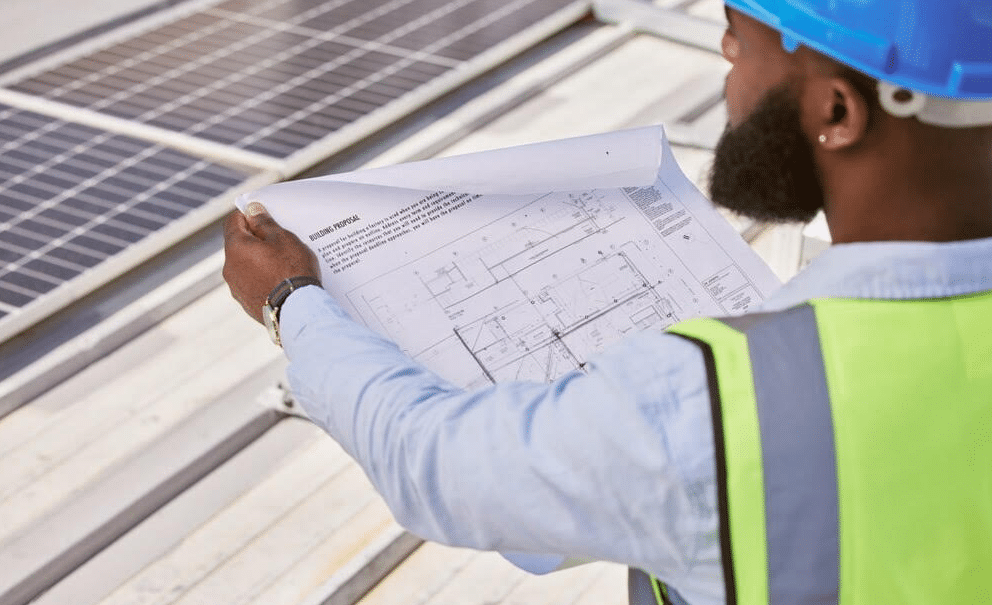Centrale photovoltaïque au sol : faut-il un permis de construire ?
La rentabilité des centrales photovoltaïques au sol n’est plus à prouver. Toutefois, avant d’en bénéficier, les porteurs de projets ont l’obligation de se renseigner sur les normes et les réglementations à respecter en France. En effet, pour sécuriser l’installation et prévenir les défaillances, le gouvernement a mis en place plusieurs réglementations et lois, notamment la loi d’accélération de production des énergies renouvelables (ENR). À cela s’ajoutent également les autorisations administratives photovoltaïques, comme le permis de construire pour une centrale solaire au sol, à demander en fonction des spécificités de chaque projet.
Cet article d’audit et due diligence photovoltaïque vous offre un tour d’horizon actualisé de la procédure d’autorisation à suivre pour une centrale solaire au sol, afin d’anticiper les contraintes d’urbanisme pour une centrale photovoltaïque et les délais d’obtention du permis de construire.
Le cadre réglementaire des centrales photovoltaïques au sol en France
Pour concrétiser un projet photovoltaïque, le porteur de projet ne peut se contenter de l’implantation de panneaux solaires au sol. En effet, c’est une opération d’aménagement du territoire qui a des conséquences sur l’environnement, le paysage et sur le site d’implantation. Par conséquent, le projet doit s’inscrire dans les orientations des différents documents d’urbanisme locaux, notamment du PLU pour l’implantation de panneaux solaires au sol.
La réglementation centrale photovoltaïque terrain encadre strictement l’implantation des installations solaires au sol afin de garantir leur conformité aux règles d’urbanisme et de protection de l’environnement. Il est donc impératif de se conformer aux dispositions légales ainsi qu’aux normes techniques applicables.
Le Code de l’Urbanisme
C’est le code de l’urbanisme qui représente le cadre juridique principal pour les installations photovoltaïques au sol. Il permet de définir les travaux soumis à la déclaration préalable ou au permis de construire et il impose une compatibilité entre le PLU et les panneaux solaires au sol. Enfin, la justification d’intérêt énergétique ou l’obtention d’une dérogation est indispensable pour les panneaux solaires installés en zone naturelle, agricole ou forestière. Lire aussi : Permis de construire ombrière photovoltaïque

Je prends rendez-vous en ligne
La loi climat et résilience
La loi Climat et Résilience ne fixe pas directement des règles spécifiques aux installations photovoltaïques au sol. Mais elle les impacte indirectement à travers la gestion du foncier, la planification territoriale et les politiques de sobriété foncière. En effet, les projets solaires au sol doivent justifier leur choix de terrains, surtout s’ils utilisent des sols naturels ou agricoles. D’ailleurs, elle encourage la priorisation des friches.
La loi APER
Mise en place en mars 2023, la loi sur l’accélération des énergies renouvelables vient compléter la Loi Climat et Résilience et traite spécifiquement du photovoltaïque au sol.
Elle permet à chaque commune de définir des espaces prioritaires, dites zones d’accélération (ZAENR), pour les projets solaires, notamment au sol.
De plus, elle accorde la priorité au foncier déjà artificialisé ou dégradé pour la réalisation des projets solaires au sol, comme :
- friches
- anciennes carrières
- zones industrielles
- parkings non utilisés.
Ainsi, les responsables peuvent instruire plus rapidement les dossiers situés dans ces zones.
Enfin, la loi APER offre un encadrement strict pour l’agrivoltaisme. Lire notre article : Centrale photovoltaïque au sol en autoconsommation.
Le Code de l’environnement
Il va de soi que la France ambitionne de développer les énergies renouvelables, en particulier pour le secteur photovoltaïque. Toutefois, cette transition ne doit pas se faire au détriment de l’environnement et des équilibres écologiques. C’est à cet effet que le Code de l’environnement impose de mener certaines études, surtout pour les grandes centrales solaires au sol. C’est notamment le cas de l’étude d’impact environnemental pour le photovoltaïque.
Le Code de l’Énergie
Le Code de l’énergie offre un encadrement pour le raccordement des installations photovoltaïques au réseau public.
Ajoutez à cela qu’il précise les obligations des producteurs d’électricité solaire pour accéder aux différentes aides photovoltaïques de l’État.
La norme pour la réalisation des panneaux solaires
Tout équipement composant une installation photovoltaïque, y compris les modules solaires, doit être conçu et installé conformément à la norme NF C 15-100. Celle-ci a été mise en place pour régir les installations électriques basses tensions.
Permis de construire ou déclaration préalable : quelle autorisation pour une centrale photovoltaïque au sol ?
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié un guide intitulé Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales solaires au sol, destiné à expliquer aux maîtres d’ouvrage les différentes procédures liées à l’autorisation administrative photovoltaïque. En effet, il mentionne la réglementation pour centrale photovoltaïque par terrain ou type de secteur, expose le déroulement de la procédure et souligne les procédures applicables, en particulier le permis de construire pour centrale solaire au sol.
La déclaration préalable
Avant toute chose, il faut savoir qu’aucune autorisation n’est nécessaire si la future installation a une puissance inférieure à 3 kWc et une hauteur maximale de 1.80 m. Par contre, si cette dernière est installée dans un secteur sauvegardé, la déclaration préalable est obligatoire.
Par ailleurs, depuis décembre 2024, en dehors des secteurs sauvegardés, une déclaration préalable suffit pour les projets photovoltaïques dont la puissance n’excède pas 3 KWc avec une hauteur de plus de 1.80 m.
Le permis de construire
Obtenir un permis de construire pour une installation photovoltaïque permet au projet de s’intégrer dans son environnement, tant sur le plan paysager que urbanistique. Il constitue un cadre formel d’instruction qui assure la conformité du projet aux règles locales et facilite la concertation avec les parties prenantes.
Le seuil permis de construire photovoltaïque est actuellement fixé à 250 kWc pour les installations au sol, ce qui signifie que tout projet dépassant cette puissance doit faire l’objet d’un permis. Toutefois, ce permis d’aménager photovoltaïque reste nécessaire pour les futures installations solaires situées en secteur sauvegardé, même si leur puissance est de 3 kWc.
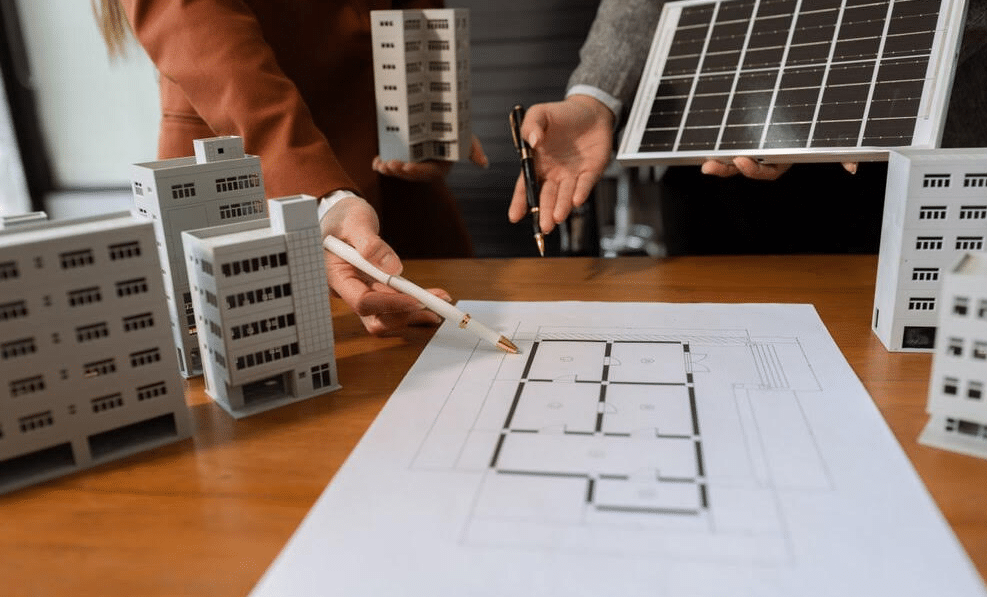
Les délais d’obtention d’un permis de construire pour une centrale solaire au sol
En France, le choix d’un terrain convenablement ensoleillé est insuffisant pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol. L’un des points stratégiques dans l’avancement de ce type de projet est l’obtention du permis de construire. Les porteurs de projets ont donc tout intérêt à anticiper les facteurs risquant d’allonger les délais d’instruction.
Il faut savoir que cette procédure administrative n’est pas qu’une formalité. En effet, il est nécessaire de fournir un dossier complet composé de :
- une étude d’impact environnemental, selon les cas ;
- des documents techniques décrivant la nature du projet ;
- une étude paysagère ;
- une enquête publique, selon le cas ;
- le formulaire Cerfa.
En moyenne, le délai d’obtention d’un permis pour une centrale solaire est de 3 mois mais tend fréquemment vers les 18 mois, à partir de la date de dépôt du dossier complet en mairie. Néanmoins, il n’est pas exclu que le délai soit prolongé.
Qu’est-ce qui peut entraîner un allongement des délais ?
L’une des principales raisons est la consultation de services extérieurs qui est souvent nécessaire dans le cas des installations solaires au sol de grandes envergures ou implantées dans une zone sensible. En effet, la mairie peut demander l’avis des architectes des bâtiments de France, de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou encore des chambres d’agriculture avant de valider une demande de permis de construire. Ainsi, chaque concertation engagée peut engendrer un délai additionnel de plusieurs semaines. Un allongement du délai peut aussi résulter d’un dossier insuffisamment documenté ou de la nécessité de mettre en place une procédure d’enquête publique, incluant la désignation d’un commissaire enquêteur.
En somme, plusieurs contraintes d’urbanisme liées à l’implantation d’une centrale photovoltaïque peuvent allonger les délais d’obtention du permis de construire, rendant indispensable une anticipation rigoureuse du calendrier de développement. Il est donc essentiel, pour tout porteur de projet, d’anticiper ces délais et d’intégrer les démarches administratives dans la planification globale de la centrale solaire, afin d’éviter d’éventuels retards significatifs pouvant engendrer des frais supplémentaires évitables.
Quels sont les documents nécessaires pour la demande d’un permis de construire ?
Pour éviter un refus de permis de construire lié à l’installation de panneaux solaires, il est essentiel de constituer un dossier complet et conforme aux exigences réglementaires. La première étape consiste à remplir le formulaire Cerfa adapté à ce type de demande, en y renseignant à la fois les informations personnelles du demandeur et les caractéristiques techniques du projet photovoltaïque. Ensuite, il faut fournir le plan de situation, pour la localisation du terrain dans la commune, le plan de coupe, pour l’illustration du profil du site, ainsi que le plan de masse permettant d’avoir une vision aérienne du terrain.
Des photomontages sont également requis afin de permettre aux autorités d’apprécier l’intégration visuelle du projet une fois achevé dans son environnement. Ce document doit être accompagné de photographies du site existant, prises à différentes distances et angles de vue, pour offrir une représentation fidèle de l’impact paysager. Enfin, le dossier de permis de construire n’est considéré comme complet qu’une fois la notice descriptive jointe. Ce document fournit une présentation détaillée du projet, en précisant les caractéristiques du terrain, les matériaux et équipements envisagés, ainsi que les modalités d’aménagement et d’intégration esthétique.
Le cadre légal du permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol
En France, le photovoltaïque au sol est encadré par la loi et l’urbanisme, avec des conditions clairement définies. Ainsi, la construction d’un parc solaire dont la puissance dépasse 3 MWc nécessite obligatoirement l’obtention d’un permis de construire. Cette obligation s’applique également aux installations de 3 MWc ou plus implantées dans une zone protégée, comme un site classé ou un secteur sauvegardé. En dessous de ces seuils, une simple déclaration préalable de travaux peut suffire, mais cette situation reste exceptionnelle dans le cas des centrales photovoltaïques au sol.
Les autorités compétentes et le rôle de la DREAL
L’instruction du permis de construire pour une centrale solaire classique se fait généralement auprès du service d’urbanisme de la mairie du lieu d’implantation. Toutefois, d’autres services déconcentrés de l’État comme la DREAL ou la DDT peuvent être impliqués. Leur intervention survient généralement au sein des projets de centrales solaires au sol d’importantes envergures ou localisées dans des zones spécifiques.
Le rôle de la DREAL dans le permis de construire consiste à s’assurer que le projet est conforme aux exigences environnementales. D’ailleurs, en fonction de la localisation du site d’implantation, d’autres acteurs peuvent prendre part à l’évaluation du dossier permis de construire pour la centrale photovoltaïque. C’est notamment le cas de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). Dans ce cas, le recours à un consultant en urbanisme photovoltaïque permet de sécuriser l’ensemble de la procédure. Ce spécialiste veille à anticiper les exigences techniques, environnementales et administratives, tout en optimisant la présentation du projet pour maximiser les chances d’obtention de l’autorisation.
AVEIL s’inscrit pleinement dans cette démarche. Grâce à son expertise reconnue et à sa maîtrise des spécificités du photovoltaïque au sol, l’entreprise accompagne les porteurs de projets à chaque étape, en combinant conseil stratégique et outils techniques, tels que la réalisation de photomontages conformes aux attentes des autorités compétentes.
Quel est son lien avec l’évaluation environnementale ?
L’obtention d’autorisations environnementales pour une centrale solaire est fréquemment requise, en particulier pour les projets de grande envergure susceptibles d’entraîner un impact visuel ou écologique significatif.
Conformément à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, la réalisation d’une étude d’impact environnemental photovoltaïque est obligatoire lorsque la puissance de l’installation dépasse 1 MWc ou lorsque l’autorité compétente estime cette analyse nécessaire. Le seuil de 300 kWc ne déclenche pas une obligation de l’autorité, mais plutôt une obligation pour le porteur de projet de soumettre un dossier à l’autorité pour un examen au cas par cas, qui, en fonction des enjeux environnementaux du site, déterminera si une étude d’impact est nécessaire.
Cette étude permet d’analyser l’impact du projet sur :
-
- le sol ;
- la biodiversité ;
- l’hydrologie ;
- le paysage.
C’est d’ailleurs pourquoi il est souvent recommandé de recourir à une assistance pour le dépôt du permis de construire photovoltaïque. Cette démarche permet non seulement de maîtriser précisément le contenu du dossier de PC pour parc solaire, mais aussi d’éviter tout allongement inutile du délai d’instruction du PC photovoltaïque.

Les contraintes locales à respecter
La réglementation d’urbanisme applicable aux centrales solaires définit les procédures encadrant leur implantation, afin d’assurer leur conformité avec les plans locaux et les exigences légales. Parmi eux, figure le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et centrale solaire qui détermine les zones où l’implantation est autorisée. Il fixe également des paramètres essentiels tels que la hauteur maximale des installations et les conditions spécifiques à respecter pour construire un parc solaire en zone naturelle ou en zone agricole.
Dans ce dernier cas, les règles relatives à la zone agricole et au permis de construire photovoltaïque revêtent une importance particulière. En effet, il est nécessaire de bien gérer les contraintes et de prouver la compatibilité du projet avec les usages agricoles.
La notice descriptive
Elle vient compléter les plans précédents pour apporter des explications approfondies sur les spécificités du projet. En effet, cette notice doit décrire :
- l’objectif de la centrale ;
- son fonctionnement ;
- les matériaux sélectionnés ;
- les aménagements supplémentaires.
En somme, c’est un document qui indique les dispositions techniques et environnementales retenues.
Le plan des toitures et des façades
Malgré l’absence de bâtiments au sens classique du terme, ce plan offre une représentation claire de l’apparence des structures prévues. Il permet ainsi aux autorités compétentes d’examiner la disposition des panneaux et leur hauteur et d’appréhender, sous différents angles, l’impact visuel global du parc solaire au sol.
Le document graphique d’insertion paysagère
Il est essentiel de situer le projet dans son environnement afin d’en évaluer l’impact visuel et paysager. C’est précisément l’objectif de ce document graphique, qui inclut un photomontage illustrant l’intégration de la future centrale solaire dans son paysage, à la fois proche et lointain.
Les photographies
Il faut inclure dans le dossier de permis de construire de la centrale photovoltaïque plusieurs photographies du site capturées sous divers angles, à courte et longue distance. Cela permet de connaître l’état du terrain et son cadre paysager actuel.
Étude d’impact environnemental
Il est tout d’abord nécessaire de vérifier si cette obligation s’applique à votre projet, en consultant un bureau d’études spécialisé ou un avocat expert en permis de construire solaire. Certes, cette démarche entraîne des frais, mais elle peut, dans certains cas, vous permettre de réaliser des économies significatives sur le coût du permis de construire pour un parc solaire, si celui-ci s’avère finalement facultatif.
Par contre, si la puissance dépasse le seuil imparti ou que le projet est localisé dans une zone sensible, la réalisation de l’étude d’impact environnemental est obligatoire pour analyser les effets des panneaux solaires sur la flore, la faune, le sol, le paysage, l’eau, etc.
Étude de danger
Ce sont généralement les projets situés à proximité de zones réglementées ou d’infrastructures sensibles qui sont concernés par ce document. Il analyse les risques éventuels et prévoit les solutions préventives adaptées afin de garantir la sécurité des biens et du public.
L’autorisation d’exploiter pour les projets sur un terrain agricole
La Direction Départementale des Territoires l’exige principalement pour les parcs solaires implantés sur des sols agricoles. Elle permet de superviser la transformation des terres agricoles en parcs solaires, afin de préserver leur vocation.

Le dépôt du permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol
Une fois les pièces techniques et administratives identifiées, le porteur de projet doit sélectionner des prestataires spécialisés pour la réalisation des études et l’élaboration des plans. À partir de là, il est possible de procéder au dépôt de la demande du permis de construire auprès de votre mairie.
Il faut savoir que le délai d’instruction d’un permis de construire photovoltaïque est généralement compris entre 2 et 3 mois, mais il peut être prolongé si l’administration demande des pièces complémentaires ou si une enquête publique est nécessaire. Pour réduire ce risque et accélérer la procédure, il est recommandé de faire appel à une assistance lors du dépôt du permis de construire photovoltaïque. Une fois la décision notifiée par écrit, le porteur de projet doit procéder à l’affichage du permis sur le site pendant deux mois afin que le public en soit informé.
Quels sont les projets relevant de la procédure d’évaluation environnementale ?
La réglementation pour l’installation photovoltaïque au sol exige aux projets dont la puissance est de 1 MWc ou plus de réaliser une évaluation environnementale. Celle-ci implique la prise en compte de l’environnement durant tout le processus de réalisation du projet.
Toutefois, il convient de noter que, dans certains cas, les autorités peuvent demander la réalisation de cet examen pour les projets dont la puissance atteint ou dépasse 250kWc. Ce cas de figure se présente surtout lorsque l’implantation envisagée peut avoir des effets significatifs sur l’environnement ou la santé publique.
L’essentiel à retenir sur le permis de construire pour une centrale solaire au sol
En France, les centrales photovoltaïques au sol dont la puissance est égale ou supérieure à 3 MWc sont soumises à une autorisation sous forme de permis de construire, conformément à l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme. Pour une puissance inférieure, une simple déclaration préalable de travaux peut suffire, selon les cas, à condition que le projet soit conforme au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en vigueur. On notera une procédure particulière pour les projets situés entre 1MWc et 3MWc.
Mais cette différence de régime ne doit pas faire oublier que d’autres autorisations peuvent être requises, et que les caractéristiques du site doivent être analysées avec rigueur. Il est essentiel d’évaluer la compatibilité du terrain avec le zonage local, d’identifier les éventuelles contraintes environnementales ou agricoles, d’analyser la sensibilité paysagère du secteur et d’anticiper les attentes des acteurs du territoire. Tous ces paramètres sont déterminants pour la mise en œuvre du projet et peuvent impacter les délais, parfois de plusieurs mois.
Pour avancer sereinement et sécuriser votre projet dès ses premières étapes, vous pouvez compter sur l’accompagnement d’AVEIL. Grâce à notre expertise réglementaire et territoriale, nous vous guidons dans la structuration de votre dossier, jusqu’à l’obtention des différentes autorisations nécessaires. Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure et accéder à nos outils dédiés à la réussite de votre centrale photovoltaïque au sol.